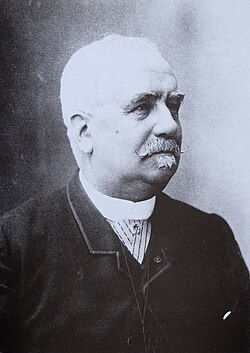«Personne ne comprend les chiens aussi bien que lui»
Le peintre, descendant de l'illustre maître du XVIIIème siècle François Boucher, naquit à Paris en janvier 1831.
De son enfance, on ne sait que peu de choses. En 1840, son père quitta la capitale pour s'installer avec sa famille à Barbizon. Charles-Olivier se familiarisa avec la proche forêt de Fontainebleau qui devint une importante source d'inspiration pour son art. Il y fit la connaissance de la première génération de peintres à fréquenter le lieu dont le plus célèbre de l'époque, Narcisse Diaz de la Peña.
Jeune homme brillant et travailleur, de Penne entra à l'école des Beaux-Arts en 1849, d'abord en tant qu'élève de Léon Cogniet puis comme élève de Waltier. Les récompenses ne tarderent pas à arriver et, dès 1854. il obtint la troisième place au concours de paysage. L'année suivante, il participa à l'Exposition universelle avec l'Arc de triomphe, dont le sujet était tiré du poème de Victor Hugo. Vainqueur du second Prix de Rome pour la toile Jésus et la Samaritaine, l'artiste séjourna également à la Villa Médicis avant que l'Etat ne lui achète deux toiles en 1859, la Halte des Bohémiens et Paysage, conservées au musée de Montbéliard. Cependant, la peinture d'histoire et de paysages ne lui permettait pas de vivre pleinement de son art et le Parisien connut d'importantes
difficultés financières. Une rencontre fut pour lui déterminante, celle de Charles Jacque, figure majeure de l'Ecole de Barbizon auquel le talent du jeune homme n'avait pas échappé. Il le convainquit en 1861, de retourner à Barbizon, et l'encouragea à illustrer des revues d'agriculture au moyen de portraits d'imposants bovins sélectionnés pour des concours régionaux. A la suite de ces premières commandes et tout au long de sa carrière, Penne chercha à élever des animaux à proximité afin de pouvoir mieux les représenter, n'hésitant pas à aménager son jardin en chenil, en cages et en volière! Il prit aussi l'habitude de fréquenter l'auberge Ganne, haut lieu de réunion des peintres de Barbizon, transformée aujourd'hui en musée. Il exécuta ainsi une huile sur bois représentant la Noce de Louise Ganne et d'Eugène Cuvelier dans laquelle on distingue la plupart des paysagistes français venus assister aux noces campagnardes. Jean Lepage évoqua le tableau en 1996, dans le catalogue de l'exposition Vins, vignes, vignerons dans la peinture française présentée au musée des Beaux-Arts de Nice et au musée de Narbonne: «Le repas de noces touche à son terme, une chaise a été renversée et un chien filoute les reliefs d'une assiette. La présence anecdotique de cet animal n'est pas sans rappeler l'art des Brueghel»...
Après s'être essayé avec succès aux scènes champêtres, Charles-Olivier exécuta des scènes de vénerie. Henri Froment, dans un Bulletin des amis de Bourron-Marlotte, écrivit « l'artiste suivait les chasses avec passion mais, trop pauvre pour y participer à cheval, les suivait à pied ou en courant!». Son Piqueur et valet de chiens de la vénerie impériale relevant un défaut fut en réalité un prétexte pour évoquer un paysage bellifontain, tandis que la toile L'enseigne d'une auberge fut décrite par la revue l'Abeille de Fontainebleau le 2 septembre 1870 comme « une composition, due au pinceau spirituel de monsieur de Penne, qui représente une table d'hôte, dressée dans un jardin à l'entrée de la forêt (...). Aux places d'honneur siègent deux veneurs, l'un vêtu de la tenue impériale, l'autre de celle de l'équipage du rallye Sivry-Courtry, à monsieur le vicomte Aguado». Le vicomte Aguado, grande figure cynégétique, symbolisa l'éclatant renouveau de la vénerie sous le second Empire et la IIIème République. Il joua un rôle déterminant dans l'approche de la chasse à courre par de Penne. «Nous suivions avec passion les chasses impériales.
Plus tard, quand nos moyens nous le permirent, nous eûmes le plaisir de suivre à cheval les chasses de l'équipage Aguado, mais je ne sais si nous eûmes jamais autant de plaisir que dans ces courses folles dont on rentrait exténués, avec un appétit superbe». Lancés, bat-l'eau, hallalis..
Le Parisien représenta toutes les péripéties d'une chasse, signant aussi d'étonnants relais de chiens et des griffons au repos à l'aide d'une touche largement brossée, associée à un dessin serré. En 1889, on lui attribua une seconde place à l'Exposition universelle, avec la présentation de deux tableaux, Chevreuil forcé et Le Lancé dans lesquels l'artiste joua habilement des transparences.
Charles-Olivier de Penne illustra par la suite deux fables de La Fontaine dont les Deux chiens et l'âne mort. «Personne ne comprend les chiens aussi bien que lui», nota un critique de l'époque. En effet, l'artiste n'avait pas oublié les conseils de Charles Jacque dispensés bien des années auparavant: « Faites donc des chiens. Il n'y a pas de grands peintres de chiens...La place est à prendre!». Il donna toute sa force aux représentations canines dévoilant le caractère de chaque animal: l'anglo-français lancé à toute vitesse sur le débucher d'un dix-cors, l'élégant setter ou le griffon nivernais, haletant et prêt à sauter aux écoutes du solitaire acculé..
Ne méprisant pas les honneurs, Penne fut célébré à Madrid, à Moscou et Chicago. Il reçut des commandes de la part de personnalités éminentes, le comte Henri Greffulhe, la princesse de Chimay et le duc d'Aumale, à qui il fut présenté à Chantilly en 1892. Les chasses des Orléans tirent une place importante dans son œuvre. Aujourd'hui, le musée Condé possède deux tableaux de l'artiste intitulés Le duc d'Orléans chassant à courre au bosquet de Sylvie et Hallali du cerf dans l'étang de Sylvie. Chasse du duc d'Aumale en 1880.
A partir de 1872, Charles-Olivier de Penne s'installa à Marlotte, un lieu-dit proche de Fontainebleau, où il jouit d'une belle notoriété et d'une renommée méritée jusqu'à sa mort en 1897.
L'animal en majesté, Jours de Chasse, Valmonde 2015.